
« Reconnaissons-le : la majorité des enfants ne réussit jamais à comprendre la signification réelle des concepts mathématiques. Au plus, ils deviennent des techniciens consommés dans l’art de manipuler des ensembles compliqués de symboles ; au pire ils sont rebutés par les situations impossibles dans lesquelles les exigences mathématiques actuelles, à l’école, tendent à les placer. Une attitude par trop courante consiste simplement à passer l’examen après quoi plus aucune pensée ne sera plus accordée aux mathématiques. »
Cette constatation n’est pas de nous, elle n’est pas non plus d’aujourd’hui mais bien d’hier puisque c’est par elle que Z. P. Dienes débute un petit ouvrage intitulé : « Construction des mathématiques » paru en… 1966 aux Presses Universitaires de France.
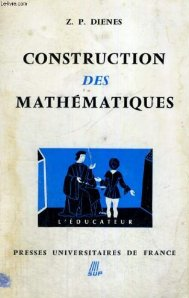
Pour reprendre une formule provocatrice, voire visionnaire, d’André Revuz : Est-il — décidément — impossible d’enseigner les mathématiques ?
Les maths, pour la plupart d’entre nous, ne sont pas une langue naturelle. Ce n’est pas un défaut de cette discipline (inutile donc de lui en faire le reproche), c’est une de ses caractéristiques, peut-être l’essence même de son intérêt. Reste que si la barrière de la langue existe, elle n’est pas infranchissable. À force de courage, de persévérance, on peut même espérer devenir « localement » bilingue.
C’est vrai qu’il faut l’envie, la motivation de parler ce langage, c’est aussi vrai qu’il faut faire un effort d’éducation de l’œil et de l’esprit pour en percevoir la beauté et la richesse mais comment lui résister quand il est finalement le seul à pouvoir se targuer d’être universel et intemporel ? Comme s’il s’agissait d’une langue « parlée », il faut accepter d’apprendre certaines règles de construction pour que, petit à petit, on soit en mesure de faire des phrases de plus en plus élaborées ; pour que, petit à petit, on soit en mesure de comprendre, de se faire comprendre, d’échanger, de transmettre, voire dans le meilleur des cas, de créer. La grammaire mathématique est difficile, en particulier parce que ses codes ne sont pas ceux de la vie courante mais ils éclairent cette vie courante comme le grec ancien peut renseigner sur le sens d’un mot, étymologie oblige.
On ne reproche pas au grec ancien d’être délicat ou contraignant alors qu’on laisse aux maths ne serait-ce que le bénéfice du doute d’autant que l’on peut vivre sans ou loin d’elles. Si je le regrette, c’est que dans une certaine mesure, les mathématiques sont une école de la vie ; elles supposent des remises en question permanentes, de la patience, de la ténacité, de l’écoute, de la réflexion et surtout de l’humilité car elles auront toujours un temps d’avance sur nous. Faire des maths passe par le fait d’accepter l’échec comme une issue possible, non plus comme une sentence ou encore une fin. On aurait envie d’ajouter que les maths ont cet avantage sur la vie qu’elles sont morales et justes.
Cette envie d’apprendre, d’en savoir plus, comment la faire naître, comment l’éveiller et lorsqu’elle est présente, comment l’entretenir quand transmettre des maths est une sorte de théorie des catastrophes de l’enseignement : des causes insignifiantes et apparemment étrangères peuvent tout arranger, tout compromettre, tout gâcher ou a contraire tout résoudre ? Comme Einstein avec Dieu, certains élèves semblent ne pas avoir besoin de cette hypothèse ; les maths ne les aident pas, ne les soulagent pas, ils n’en voient ni l’intérêt ni la nécessité ; d’autres au contraire y trouveront un lieu de repos, une terre d’asile, sécurisante et apaisante. On fait des maths différemment suivant son histoire personnelle, suivant son interlocuteur.
Il faudrait donc presque une réforme par personne ou par « classes d’équivalence de personnes » ; les maths sont probablement trop sensibles aux conditions extérieures, trop délicates pour s’épanouir dans un enseignement de masse.
Il faut dire que l’on est passé du tout démesurément abstrait à cette époque aujourd’hui décriée où le recours à l’intuition, notamment graphique, était perçu comme une souillure (on pense notamment à la définition désormais aussi célèbre qu’angoissante de la droite affine) à une perte totale de contenus, de « matière » à force de simplifications, à force de cas particuliers et parfois de cas concrets mal maîtrisés qui viennent trop tôt et trop durablement couper les ailes de l’imagination des élèves.
Les objets mathématiques peuvent être mis en situation c’est vrai, être mis au service des sciences humaines, des sciences physiques qui sont un vivier de motivations pour la recherche mais rappelons qu’ils sont ou seraient légitimes sans cela. Il faudrait donc dans un premier temps réintroduire dans l’esprit des jeunes gens le goût et le respect pour le raisonnement, le raisonnement sans autre but que lui même, que la recherche de la cohérence, le plaisir et la satisfaction d’avoir compris le déroulement d’une argumentation ou d’en avoir repéré les faiblesses.
« Le tout utilitaire » a fait des élèves des consommateurs souvent lassés, inattentifs, qui subissent les chapitres sans les vivre, sans les lier en attendant que cela passe, que cela cesse. Passer par la modélisation, raisonner à partir de cas particuliers peut autant aider que corrompre si bien que la généralité n’est pas toujours l’ennemie que l’on croit.
Les idées de classifier suivant un caractère, de créer une mesure de défaut par rapport à une situation idéale, d’exhiber des contraintes d’existence sont complètement occultées dans le secondaire ; la notion d’ensembles est elle aussi estimée trop générale, trop abstraite si bien que l’on tâche de la contourner, de la retarder, de la limiter à quelques exemples simples qu’à défaut de comprendre on pourra toujours mémoriser. Malheureusement parmi les très nombreux élèves de seconde qui ne comprennent pas la notion d’ensembles de définition d’une fonction, on retrouvera en terminale S des jeunes gens complètement déroutés par la notion de limite dont ils ne comprendront pas la nécessité.
Bien sûr, il reste quelques questions à l’occasion des chapitres sur les vecteurs en 1èreS ou concernant les nombres complexes en terminale où l’on se propose de déterminer « l’ensemble des points M du plan tels que… » mais la plupart des élèves résolvent ces questions par mimétisme, par « exclusion » ou encore par élimination car ils savent par expérience qu’il s’agit toujours d’un cercle ou d’une droite.
Les droites d’ailleurs, parlons-en. Les élèves les manipulent depuis les premières années du collège et pourtant faire comprendre aux lycéens ce que signifie l’appartenance d’un point à une droite est un véritable parcours du combattant. Ils ne saisissent pas en général qu’une équation de droite réalise, « concrétise » une contrainte, une règle édictée qu’un couple de coordonnées peut ou ne pas satisfaire. Pour ces jeunes, il n’y a finalement aucune différence notable entre l’ expression 2x−3 et la relation y=2x−3.
Ils ne cherchent pas réellement à comprendre les questions peut-être par manque de confiance mais souvent par manque d’envie ; ils ne cherchent pas à les reformuler, pas non plus à se les approprier, ils n’en ont tout simplement pas l’idée. Les élèves d’aujourd’hui cherchent à se souvenir. On a le sentiment qu’ils ne sont qu’une « mémoire » animée, plus ou moins entraînée, plus ou moins fiable à l’identique des appareils qui encombrent leurs poches. Bref, c’est une version 3G des élèves avec laquelle il faut désormais composer, pour le meilleur et pour le pire…
Ils sont durant le cours de maths en terre étrangère mais délestés de toute curiosité donc plutôt en danger finalement ; un milieu est perçu hostile lorsque l’on n’y est pas ou mal préparés. La chance, le hasard sont préférés aux raisonnements décidément trop coûteux. Comment pourrait-il en être autrement à l’ère des Vrai-faux et des QCM qui sont désormais légion au bac ?
J’ai en mémoire quelques mots lors d’une intervention orale du philosophe Georges Didi Huberman à propos de l’œuvre de Baudelaire qui s’adapte complètement à l’apprentissage des mathématiques et qui disait en substance que créer des relations entre les choses, des correspondances, des analogies, c’est de cette façon que l’imagination génère un savoir, un savoir encore inaperçu (de soi tout au moins) mais un savoir pérenne, dont on sera le « maître » parce qu’on aura le sentiment de l’avoir engendré au point de pouvoir le transmettre, le compléter, le refondre.
L’autonomie libératrice, c’est justement le cadeau qu’on voudrait tant pouvoir leur offrir, qu’on voudrait tant qu’ils acceptent.
Les maths sont une discipline du long terme : la version « micro-ondable » prête en deux minutes manque de texture, de qualité nutritionnelle. On croit sur l’instant que les choses sont acquises mais rapidement le doute s’installe. On ne peut comprendre vite que ce qu’on vous a expliqué longtemps !
L’introduction de l’algorithmique au lycée est justement motivée par le fait qu’elle devrait aider les élèves à extraire la substantifique moelle (au sens « le squelette », « la trame ») des raisonnements. Je suis terriblement sceptique vis-à-vis de cet argument ; les élèves ne sont pas soulagés et encore moins intéressés par cette nouvelle manière de traduire une instruction. Ils la trouvent obscure et contraignante car elle est en elle-même un nouveau langage, un langage de plus quand les maths seules posent déjà problème et quand le français pose problème (avec bien sûr une intersection non-vide).
Des initiatives pour modifier la forme des cours (jusqu’à la mesure extrême de se dispenser de tout cours magistral et de découvrir les objets via les exercices 🙁 ), il n’en manque pas et pourtant tout se perd et rien ne semble se créer sinon une profonde incompréhension et une utilisation massive de la calculatrice au point que les performances de cette dernière édicte parfois le mode de résolution.
Avant les programmes, le premier problème qui se pose est humain, relationnel. Dans une classe de quarante, on ne rencontre pas les élèves, on les survole et les compte. Il faudrait rétablir une proximité, car d’elle seule peut naître une relation de confiance qui est une condition presque toujours nécessaire aux progrès. S’il n’est pas possible de dédoubler les effectifs, il faudrait selon moi copier le principe des khôlles dès la classe de seconde pour se confronter aux incompréhensions au fur et à mesure qu’elles émergent. La parole est un outil plus convivial que l’écrit et toujours complémentaire.
Lorsqu’un devoir est loupé, le prof se sent trahi (car il a fait de son mieux … parfois), les élèves aussi (car ils ont fait de leur mieux… parfois) et le dialogue se fragilise avant de risquer d’être rompu. L’introduction d’oraux pourrait être l’occasion d’un échange devenu trop rare.
Les programmes enfin sont le siège d’un éternel dilemme car ils sont tout à la fois « trop » et « trop peu » ambitieux. Trop ambitieux par la diversité des thèmes abordés notamment en terminale S ; « trop peu » car tout est survolé de manière tellement artificielle, anecdotique que rien ne semble jamais écrit ailleurs que dans du sable. En maths comme ailleurs, on a besoin de repères, d’une toile qui nous permette de tisser des liens pour établir ces fameuses correspondances qui ne sont pas chères qu’à Baudelaire :
Les piliers mathématiques tardent trop à être abordés sans doute. La jeunesse est parfois un avantage pour une certaine forme d’abstraction car elle est libre et décomplexée. En maths, il faut oser parfois.
Il s’agit d’un constat partiel, personnel, forcément partial et suggéré par mes précieuses victimes depuis neuf ans (je leur rends hommage ainsi qu’à Amandine et ses élèves pour leur patience et les mots -surtout les maux en fait- qu’ils ont acceptés de nous confier pour guider ma réflexion) ; le débat continue… pour eux, pour eux surtout et avant tout.
Post-scriptum
Je tiens à remercier chaleureusement A. El Kacimi, F. Recher et V. Vassallo pour l’invitation à participer à cet échange du 18 et au-delà !


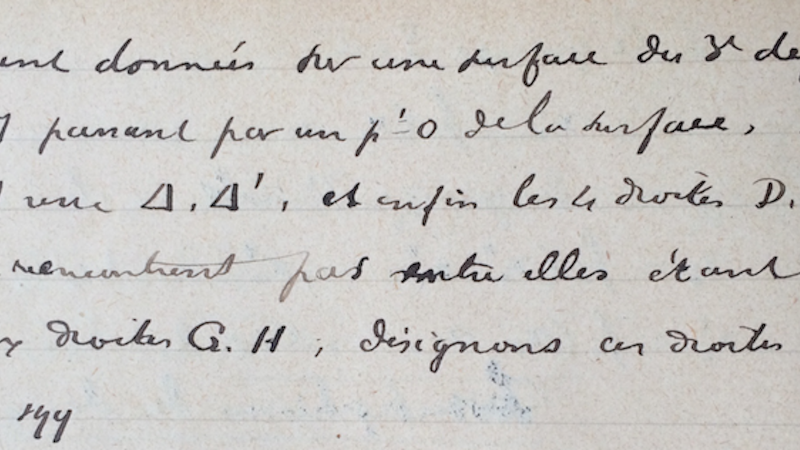
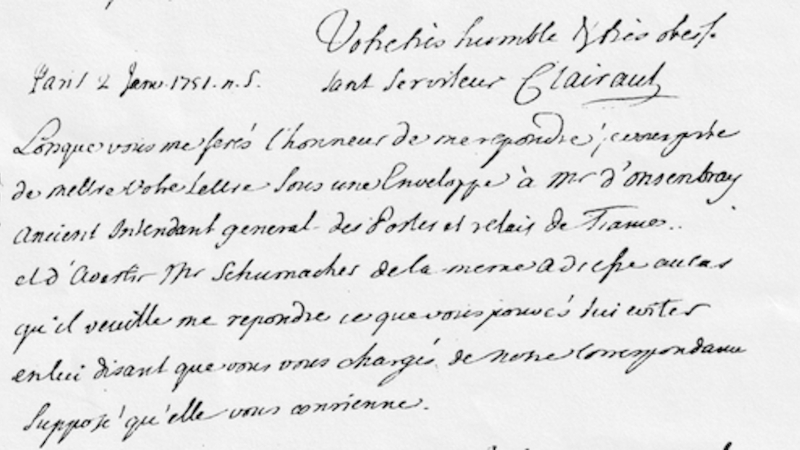

15h01
Voir les 8 commentaires