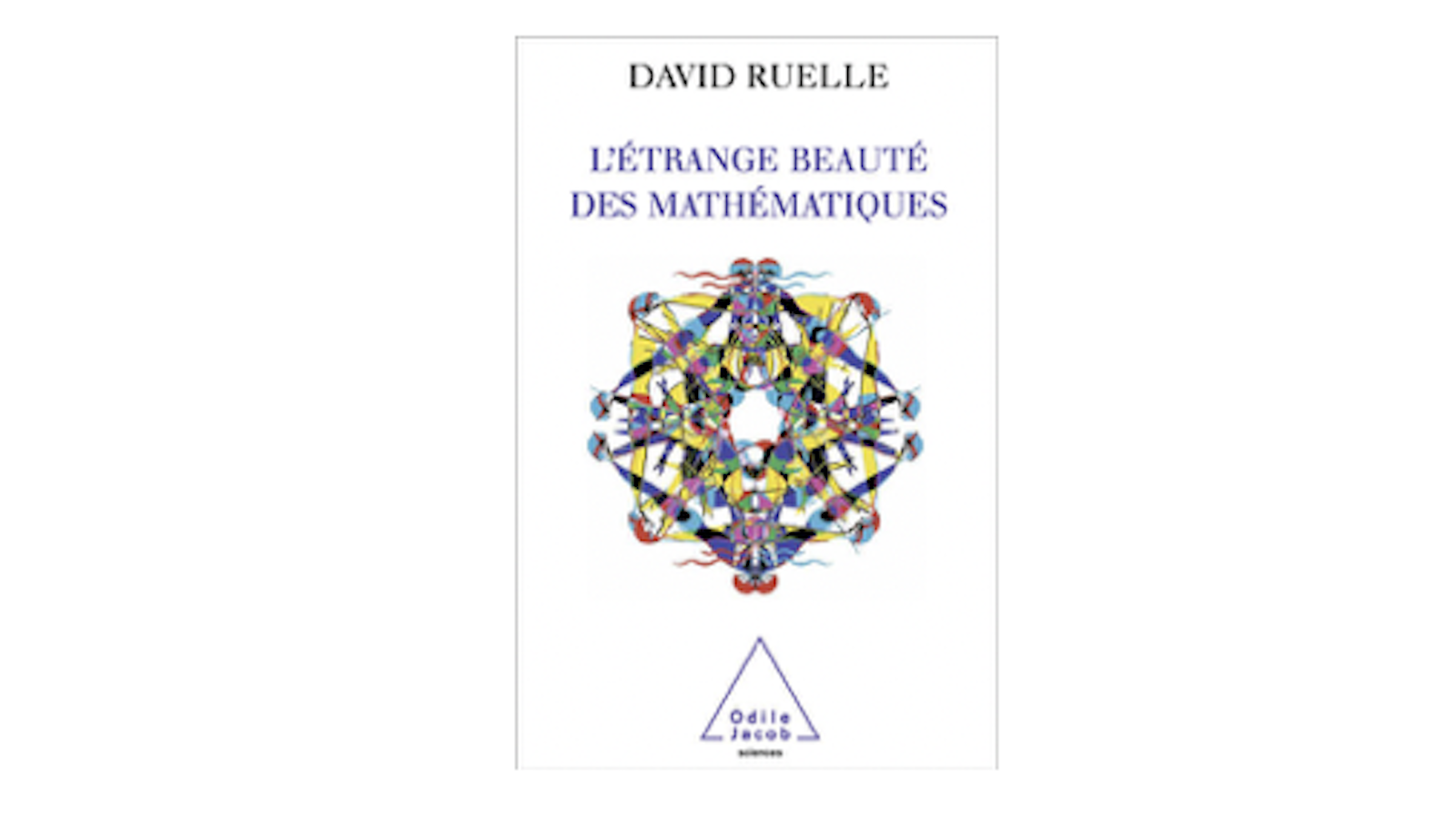
Un livre sur les mathématiques et les mathématiciens, destiné à un large public ? Pari risqué ? Mêler mathématiques et beauté dans le titre pourrait surprendre, tant les souvenirs mathématiques de nos concitoyens sont souvent douloureux et n’évoquent guère la beauté. « Et pourtant, certains d’entre nous trouvent de la beauté dans les mathématiques. »
Les mathématiques sont une activité humaine et « notre sens humain de la beauté n’est pas strictement gouverné par la stricte logique ». « Ce qui nous attire, nous frêles humains, vers les mathématiques, c’est qu’elles confrontent l’incertitude et le caractère relatif de la pensée humaine à l’absolue certitude de la vérité mathématique. »
« Alors que le statut de l’Homme et des mathématiques a été radicalement revu, la relation entre les deux partenaires a remarquablement peu évolué depuis les grecs. Cependant, cette relation (on pourrait dire la beauté de cette relation) a été l’objet de ce livre. »
Voilà donc le thème : l’étrange beauté des mathématiques en tant qu’activité humaine.
David Ruelle est professeur de Physique Théorique à l’Institut des Hautes Études Scientifiques. Un physicien pour parler des mathématiques ? Mais s’agit-il vraiment d’un physicien ? Bien des lecteurs de ses articles scientifiques n’hésitent pas à cataloguer D. Ruelle comme un mathématicien. C’est précisément ce statut de physicien/mathématicien qui lui donne une expertise unique : un observateur du monde mathématique à la fois extérieur et intérieur, dont le regard est souvent sans pitié, mais presque toujours émerveillé.
« Ce livre est écrit pour les lecteurs de tout niveau mathématique (y compris minimal) ». Il est vrai que Ruelle fait l’impossible pour qu’une bonne partie de l’ouvrage ne nécessite que peu de connaissances mathématiques. Presque toujours, il y réussit. Mais le livre est aussi écrit pour des lecteurs scientifiques : « J’y ai aussi inséré quelques véritables mathématiques, faciles et moins faciles ». Comment concilier des lecteurs aux intérêts différents ? Ruelle « encourage le lecteur, quelle que soit sa formation, à faire un effort pour comprendre les paragraphes mathématiques, ou au moins de les lire, (quitte à ne guère les comprendre) plutôt que de passer directement aux chapitres suivants ». Je suis dubitatif… Cela me semble une illusion ; lire sans comprendre ? Les nombres complexes, la géométrie projective, les variétés algébriques, ZFC ? Je ne pense pas que les maths soient comme ces chansons populaires polonaises dont l’auteur nous parle au chapitre 17 : « Je ne parle pas polonais et je ne comprenais pas le sens des chansons mais cela n’avait pas beaucoup d’importance, ce qui comptait, c’était la façon très particulière dont elles étaient chantées ». Pour les chansons polonaises, peut-être ? mais pour les maths, je n’y crois guère. Mon conseil au lecteur néophyte serait donc opposé : si vous ne comprenez pas le polonais et si vous ne percevez pas la tonalité de la voix de Ruelle dans tel ou tel paragraphe ou chapitre, passez au chapitre suivant ! A l’inverse, les lecteurs scientifiques trouveront bien sûr que tel ou tel paragraphe est trop « élémentaire » ; qu’ils n’hésitent pas à le sauter ! Tout cela est possible grâce à la structure « en tiroirs » du livre : vingt-trois chapitres très courts qui sont presque indépendants… Chaque tiroir contient de jolies choses ; le lecteur aura plaisir à les ouvrir dans l’ordre qui lui convient, quitte à devoir en refermer un de temps en temps parce qu’il est « chanté en polonais », ou parce que son contenu l’encourage à ouvrir un autre tiroir.
J’aime bien la comparaison qu’on trouve dans le tiroir 14 entre l’activité du mathématicien et l’escalade. L’escalade implique bien sûr un être humain qui grimpe sur un rocher qui n’est pas humain. Le rocher est ce qu’il est, mais l’homme choisit sa propre voie d’accès (et certains sont plus doués que d’autres à ce sport). Une question bien connue des mathématiciens est de savoir si des extraterrestres seraient d’accord avec eux, disons sur la preuve du théorème de Pythagore ? ou encore de savoir si les mathématiciens extraterrestres auraient été indépendamment conduits au même théorème de Pythagore ? « Il est clair que les problèmes rencontrés par un lézard ou par une mouche qui escalade une falaise sont totalement différents de ceux que rencontrent un alpiniste humain ». Ruelle discute aussi d’autres mathématiques « inhumaines » et d’autres formes d’intelligence. Il consacre un chapitre à la comparaison entre un cerveau humain et un ordinateur (et il s’agit d’ailleurs d’un de ces chapitres tout à la fois intéressants, accessibles sans bagage mathématique, et indépendants des autres). Il signale aussi la sélection naturelle en biologie : une forme d’intelligence empirique et non conceptuelle — donc bien différente de « nos » mathématiques — qui a pourtant résolu bien des problèmes complexes, comme par exemple celui de fabriquer des cerveaux humains. Oui, décidément, les mathématiques telles que nous les entendons sont une activité humaine et il est heureux que ce livre les aborde de ce point de vue.
Beaucoup de merveilles dans ces tiroirs… On y parle de maths, bien sûr, de mathématiciens, mais aussi de la communauté des mathématiciens, de leurs méthodes de travail, de leurs habitudes, leur psychologie, et même de leur inconscient. Quelques exemples :
De mathématiciens. Le chapitre 7 — Un voyage à Nancy avec Alexandre Grothendieck — est passionnant, à la fois pour les mathématiciens — qui savent ce que Grothendieck représente pour les mathématiques du vingtième siècle — que pour ceux qui ne connaissaient pas ce nom auparavant. Ruelle, qui a bien connu ce mathématicien exceptionnel dont il était le collègue, apporte un témoignage sur la façon dont il a tout simplement révolutionné la géométrie algébrique et la théorie des nombres, mais aussi sur ses méthodes de travail, sur sa personnalité, et sur ses rapports avec ses collègues. Au faîte de sa carrière, après avoir accompli un travail considérable, Grothendieck abandonne les mathématiques soudainement, à l’âge de 42 ans. Beaucoup de mathématiciens (dont moi-même) ne connaissent qu’une partie de l’histoire, la plus belle… Ruelle y apporte des éclairages plus nuancés, sur les liens de pouvoir, sur le corporatisme à l’intérieur du monde des mathématiciens, et sa conclusion est dure : « Il s’est passé quelque chose de peu honorable. Et l’élimination de Grothendieck restera une tache dans l’histoire des mathématiques du XXème siècle ».
Des maths. On conseille souvent à l’apprenti mathématicien de ne jamais faire de conférence sans y démontrer quelque chose, même si ce quelque chose est un théorème facile. Ne jamais parler de maths sans en faire. Ruelle connaît bien ce conseil, et il en donne deux très belles illustrations. Dans le chapitre 4, il démontre le « théorème du papillon » : un théorème de géométrie du plan, dont on comprend facilement l’énoncé mais dont la démonstration est « belle ». Une fois placée dans son contexte naturel (dans ce cas la « géométrie projective »), il devient évident. Bien sûr, il aura fallu travailler (ou, plus précisément, beaucoup de nos prédécesseurs auront du travailler) pour expliciter ces structures qui permettent de « voir » ce théorème comme une évidence. Un regret sur cet exemple : je ne suis pas convaincu que le lecteur dont le niveau mathématique est minimal pourra saisir la démonstration, et cette beauté lui restera peut-être inaccessible.
Je ne connaissais pas le théorème du cercle de Lee et Yang. J’ai beaucoup aimé ce chapitre 17 qui commence précisément par la comparaison avec les chansons polonaises… Comme je l’ai dit plus haut, il me semble préférable de le sauter si on ne parle pas « polonais ». C’est dommage pourtant puisqu’en quelques pages, Ruelle nous énonce un théorème relativement technique et nous le démontre. En faisant cela, il illustre à merveille ce qu’est une démonstration mathématique pour un être humain, et ce qui la différencie d’une vérification par ordinateur. En lisant ces quelques pages, je n’ai vérifié aucun détail, je ne suis évidemment pas revenu aux axiomes de base, mais je sais que le théorème est vrai. La discussion qui en suit, attribuant une dimension infinie à l’espace mathématique, est vraiment intéressante si on est mathématicien ; je pense malheureusement qu’elle restera hermétique aux autres lecteurs.
Une communauté culturelle mathématique. Ruelle connaît parfaitement le milieu des mathématiciens et son livre regorge d’informations intéressantes, pas seulement pour les non mathématiciens : « l’important pour de nombreux mathématiciens est de se sentir membre d’une élite qui partage un trésor intellectuel ». Ruelle discute de la manière dont cette communauté décide de ce qui est intéressant. De nombreux auteurs ont déjà analysé « L’invention mathématique » — en particulier Hadamard et Poincaré il y a un siècle — et l’une des théories généralement admises est que le critère qui guide le mathématicien dans ses choix est avant tout esthétique. Ruelle y ajoute une composante culturelle : « Une culture mathématique donnée, à une époque donnée, fait référence à des théorèmes standard, à des procédures, à des manières de penser, qui définissent cette culture ». Les mathématiques sont bien souvent une activité individuelle, mais dans un contexte culturel en constante évolution : voilà qui surprendra ceux qui pensent aux mathématiques comme des vérités immuables et froides, et qui ne surprendra pas ceux qui connaissent le monde des mathématiciens.
Beaucoup de merveilles dans ces tiroirs… On y verra par exemple que les erreurs ne sont pas absentes de la vie mathématique, que le vrai, le faux, le démontrable, l’indécidable, le calculable etc. sont plus subtils qu’il n’y paraît, mais que « fondamentalement, on peut dire que de bons mathématiciens, travaillant dans un domaine donné, connaissent le degré de fiabilité de la littérature dans ce domaine ». Une activité humaine…
Ouvrez et fermez les tiroirs. Je pense que D. Ruelle aura gagné son pari si le lecteur en retire l’impression que les mathématiciens sont des êtres humains… « Il ne faut pas oublier que, à côté d’idées admirables, il y a beaucoup de choses plus obscures qui grouillent dans le cerveau du mathématicien ».


19h12
Je suis journaliste scientifique et vulgarisateur ; après avoir été longtemps
du même avis que celui d’Étienne Ghys sur la lecture-en-comprenant — inutile
de se forcer « si l’on ne parle pas polonais » — je pense maintenant comme
David Ruelle : lire, même sans comprendre mais en faisant un petit effort,
permet de progresser dans le domaine, même si ces progrès ne sont pas
d’emblée très visibles. Ils se révèlent en fait à la relecture quelques
heures plus tard, ou mieux, le lendemain. C’est qu’on emmagazine toujours
quelque chose : ne fût-ce que du vocabulaire, un petit savoir sur l’existence
de concepts… Et c’est « toujours ça de pris » lorsqu’on y revient ensuite.
Après tout, n’est-ce pas ainsi que nous avons tous appris à parler le
français ?! En écoutant les conversations des « grands » alors que “nous ne
parlions pas polonais” ?!
Notre cerveau bosse à notre insu ; sachant cela, lui faire un minimum
confiance à ce propos libère des potentialités d’apprentissages et de
compréhension étonnantes.
J’ajoute que rendre les élèves et étudiants conscients de ce phénomène
rabaisserait considérablement le niveau de stress du « je ne comprends pas »,
tout en renforçant l’estime-de-soi du jeune mathématicien.
Stress et faible estime de soi : deux grandes raisons au « décrochage » en
maths.
Alexandre Wajnberg
9h46
“lire, même sans comprendre mais en faisant un petit effort, permet de progresser dans le
domaine, même si ces progrès ne sont pas d’emblée très visibles. Ils
se révèlent en fait à la relecture quelques heures plus tard, ou mieux,
le lendemain. ”
Vaste débat, tout à fait passionnant ! A mon avis, il faut distinguer beaucoup de niveaux différents et votre point de vue ne peut s’appliquer qu’à certains d’entre eux. On peut parler de vulgarisation, de recherche scientifique, ou encore d’enseignement. On peut parler de mathématiques, d’autres sciences, ou encore d’autres formes de cultures. Je pense que chaque combinaison a ses caractéristiques propres.
Par exemple, lorsqu’il s’agit d’enseignement, auquel vous faites probablement allusion en parlant de « décrochage en maths », je ne pense pas qu’il soit une bonne pratique pédagogique de « lire sans comprendre » lorsqu’il s’agit de mathématiques. Peut-être que c’est raisonnable pour d’autres disciplines mais pas pour les maths. Autrement dit, je pense qu’il n’est pas bon de dire, « je ne comprends pas trop le théorème de Pythagore, ce n’est pas grave, on verra bien par la suite, ça viendra peu à peu, continuons ». Cela ne veut absolument pas dire que je recommande de comprendre tout d’un seul coup, et qu’il ne faut pas réfléchir quelques heures plus tard, ou le lendemain, de manière consciente ou inconsciente ! Je pense qu’il faut aborder les concepts progressivement, faire des exercices d’applications etc. mais chaque étape, même modeste, doit être assimilée, sans tricher sur la compréhension. Cela ne veut pas dire non plus que l’enseignant doit donner une seule chance à l’élève et que si on « loupe » une étape, on décroche pour toute la suite. L’enseignant doit donner plusieurs fois de nouvelles approches de la même chose. Ne dit-on pas « Enseigner, c’est répéter » ? Mais à mon avis, un enseignant de mathématiques ne devrait pas « expliquer à moitié », même pour la bonne cause. J’insiste cependant sur le fait que je ne suggère pas de placer immédiatement un concept ou un théorème dans son contexte le plus large possible. Je ne recommande pas d’expliquer d’abord le théorème de Pythagore dans le cadre des espaces de Hilbert ! Mais un fait mathématique, même modeste, même s’il n’est qu’un cas particulier d’une théorie générale, doit être assimilé comme il est, pas à moitié.
En ce qui concerne la recherche mathématique, mon expérience est que cela dépend énormément des individus. Personnellement, il n’est pas rare que je décroche complètement pendant un exposé de recherche mathématique, peut-être parce que je ne connais pas le vocabulaire de base, ou bien parce que je ne connais pas les motivations, ou parce que le débit est beaucoup trop rapide pour moi. Ce décrochement est extrêmement soudain : la minute qui précédait, je suivais ce que le conférencier disait, et la minute qui suit, je ne comprends plus rien ; il n’y a pas de période intermédiaire. Dans ces circonstances, je sais que c’est « fichu » pour moi. Je sais que je ne pourrai jamais tirer quelque chose d’une conférence à laquelle je n’ai rien compris. Il va de soi que la réflexion personnelle, encore une fois consciente ou inconsciente, à laquelle vous faites allusion, est très importante : elle permet de comprendre mieux ce qu’on avait déjà compris en partie. Mais pour moi, elle est inefficace lorsqu’on a rien compris du tout ! D’autres y parviennent mieux que moi. Je me souviens par exemple que j’assistais sans rien comprendre à une conférence alors que j’étais postdoc. J’étais assis à côté de mon mentor, Dennis Sullivan, pour lequel j’ai une admiration infinie. Alors que je lui demandais s’il comprenait quelque chose, il m’a répondu « Non, je ne comprends absolument rien aux paroles mais j’écoute la musique » ! Il est vrai que Sullivan a une telle culture mathématique que tout est plus facile pour lui. D’autres collègues trouvent d’autres occupations quand ils arrivent à ce moment de non retour où « c’est fichu ». Je me souviens avoir demandé à un collègue (dont je tairai le nom !) qui semblait écouter avec attention « Tu comprends quelque chose ? ». Il m’a répondu « Non, rien du tout ! mais je vérifie que le conférencier referme bien toutes les parenthèses des formules qu’il écrit au tableau ! » Puisque j’en suis à raconter des souvenirs, en voici deux de plus ! Le premier est une phrase que répète souvent un collègue que je respecte beaucoup : « Les maths, ça s’apprend par osmose ». Il voulait justifier par là le fait qu’un jeune chercheur débutant doit passer de nombreuses conférences à ne rien comprendre stoïquement avant de comprendre quelque chose. Le second souvenir est celui d’une conférence alors que je préparais ma thèse. Le conférencier était mon directeur de thèse et le public se réduisait à ses étudiants. Alors qu’il avait prononcé le mot « fibration » sans réaction de notre part, il s’arrête, et nous interroge un à un pour voir si nous savions ce qu’est une fibration. Personne ne le savait et nous n’avions pas posé la question. Belle engueulade, dont je me souviens encore, et qui était méritée : nous étions pris en flagrant délit de tricherie avec les maths. On ne peut pas deviner tout seul la définition des fibrations (et d’’ailleurs il y a tellement de définitions différentes…)
En ce qui concerne la vulgarisation, la situation est peut-être différente, mais je suis convaincu que les maths sont encore particulières. Je pense qu’en maths, il y a un vocabulaire qui nécessite des explications. Sans ces explications, il me semble que la porte de la compréhension est impossible, non seulement dans l’immédiat, mais aussi demain ou après-demain ! Prenons l’exemple dont je parle dans cette présentation du livre de D. Ruelle : le théorème décrit dans le chapitre 17 (et qui commence par l’allusion aux chansons polonaises). Je suis convaincu qu’un lecteur qui n’a pas suivi un cours de mathématiques du niveau premier cycle scientifique n’a aucune chance de jamais comprendre ce chapitre, même dans ses grandes lignes. Probablement d’ailleurs parce que sa première lecture sera tellement rébarbative pour lui qu’il ne cherchera pas à comprendre quelque chose. Mais aussi parce qu’il y a bien trop de mots qu’il n’a aucune chance de comprendre (sans acheter des bouquins de maths auparavant). En résumé, il me semble qu’en maths bien plus que dans les autres sciences, on ne peut pas tricher avec les mots. J’ai bien souvent l’impression que dans la vulgarisation d’autres disciplines, ce n’est pas la même chose. Prenez l’exemple de la biologie : combien de lecteurs d’un quotidien savent ce qu’est une protéine, ou même une hormone ? Et pourtant, cela ne gêne pas l’essentiel de leur lecture. En maths, si j’utilise par exemple le mot « dérivée » sans l’expliquer, je suis persuadé que ce qui suit est incompréhensible par presque tous les lecteurs (sauf bien sûr ceux qui ont suivi un cours de calcul différentiel). Dans cet exemple, des solutions sont possibles : je peux ruser, parler de vitesse, d’accroissement, ou d’autres choses, alors que dans l’article de biologie, on peut écrire « protéine » sans prendre garde : on sait que le lecteur ne sait pas exactement ce dont il s’agit mais qu’il en a déjà entendu parler, et que cette connaissance diffuse est suffisante pour continuer et même pour comprendre. J’aime bien cet exemple : la notion de dérivée est tellement fondamentale pour toutes les sciences, et elle est si ancienne (17ème siècle). La comparaison est frappante avec les protéines, concept certes fondamental mais limité à une science, et dont la compréhension est très récente. Et pourtant, le public l’accepte comme un concept flou qui lui suffit bien.
Vous dites que les enfants apprennent bien une langue en écoutant leurs parents. Certes, mais les miens ne me déclamaient pas du Proust ! et puis le processus d’apprentissage d’une langue est un peu plus long que les quelques jours dont vous parlez. En ce qui me concerne, j’ai passé un mois à Varsovie et je ne parle toujours pas le polonais !
Quand vous dites : « Stress et faible estime de soi : deux grandes raisons au « décrochage » en maths », je suis complètement d’accord avec vous ! Mais je ne pense pas que la solution consiste à expliquer les choses « à moitié » aux élèves.
Merci beaucoup pour votre message ! J’espère en tous les cas que ma description du livre de Ruelle vous a encouragé à le lire !
15h51
Je suis quand même plus de l’avis de Alexandre, et aussi donc de D. Ruelle, en ce qui concerne la vulgarisation. Je pense que les membres de la communauté mathématique considèrent comme essentielle la clarté des arguments pour traquer, comme de juste, l’erreur toujours possible. La communauté développe ainsi dans ses codes de comportement un souci du détail et une traque de l’approximatif. Celà est encore une fois louable.
Mais imposer toutes ces règles dans la démarche de vulgarisation amène un handicap insurmontable, rendant incommunicable l’essentiel des activités de recherche actuelles, et en la concentrant sur quelques cas idoines et qui se prêtent le mieux à la démarche. C’est fort dommage, alors qu’en assouplissant l’exigence, comme le fait D. Ruelle, on élargit la vision et donne une image plus véritable sur la recherche actuelle. Vulgariser, ce n’est pas enseigner !
Tu donnes d’ailleurs l’exemple de la biologie : peu de lecteurs de quotidien en effet comprennent vraiment ce qu’est une protéine ou une hormone, mais ils en ont une idée ! Et c’est là le point ! L’essentiel n’est pas que le lecteur comprenne, au sens mathématique du terme, mais qu’il est la sensation de comprendre, et que sa compréhension ne soit pas trop éloignée du correct ! On peut ajouter l’exemple de l’adn, de la théorie du big bang, grands succès de vulgarisation, qui se sont fait sur pas mal « d’esbrouffe » ! Si la physique quantique est si bien vulgarisée, comment se fait-il que les mathématiciens n’arrivent pas à améliorer la connaissance de leur matière ? La majorité de la population continue de penser qu’ils passent leurs journées à faire de longs calculs ou à dessiner des triangles.
Il faut bien sûr veiller à ce que les propos vulgarisés soient corrects, et c’est justement notre chance en mathématiques que celà soit particulièrement facile à être vérifié : s’il y a contestation, ce n’est pas sur la validité d’un résultat, mais sur son intérêt.
Dans bien d’autres sciences, le consensus est beaucoup plus difficile à obtenir !
Je crois important, et particulièrement en cette période délicate, que nos concitoyens sachent enfin que, entre autre, la théorie du chaos, c’est l’étude du mouvement. Ajouter des détails et considérations sur les notions de transformations, sur les subtilités entre mesures boréliennes invariantes et/ou stationnaires absolument continues par rapport à Lebesgue, c’est ipso-facto restreindre drastiquement la liste des lecteurs potentiels si on le fait en n’omettant aucune de leurs particularités. Il y a tant à dire, et possibilités de le dire, si on écarte l’obsession purement professionnelle de la rigueur intellectuelle telle qu’elle est cultivée (à juste titre !) entre les mathématiciens.
8h01
Je voudrais illustrer ce débat par une citation de Lebesgue qui tombe bien après ce que vient de dire Thierry.
Je n’ai, pour ma part, jamais compris bien les cours que j’ai suivis que fort longtemps après.
Lettre d’Henri Lebesgue à Émile Borel du 26 août 1904
in Les lendemains de l’intégrale Vuibert 2004.
1h24
Est-ce qu’en 2014 les idées ont changé ? si j’essaie de rationaliser, je me dis que, psycho sociologiquement, il y a deux sortes de maths : les maths des mathématophiles et les maths des mathématophobes. et que dans ces deux immenses nations il y a des tribus et des clans et des échelles moult différentes. comme je suis de la nation des mathématophiles, je me pose la question : pourquoi les maths me fascinent-elles ? il y a les réponses psychologiques, sociologiques, politiques, économiques et que sais-je encore ? mais il me semble que la réponse n’est qu’artefact dans ces domaines. voilà c’que j’dis : passée la matérialité des corps initiaux à partir desquels s’est constituée la mathématique, petits cailloux, nombre de soldats, richesse et tutti quanti, cela a débouché sur des petits signes. et donc, que j’me dis c’est ces petits signes qui m’attirent. on les voit nulle part que sur des tableaux noirs (et franchement ça fait joli même quand on comprend pas ! – dans « le jour où la terre s’arrêta », cette scène où l’extra-terrestre résout des équations à coup sûr einsteiniennes sur le tableau noir du savant…!ah la la !) ou des feuilles de papier. la consistance, la puissance révélées par ces petits signes sont sans commune mesure avec ces écritures ! et que ça passe par notre cerveau, c’est dingue !!! au point qujmedis c’est not cerveau quça explore. le monde est mathématique, allez dire ça à mon chat (nono i s’appelle). et donc que jme redis c’est moi que j’investis de ces petits signes et que je me repais de moi-même. et c’est pourquoi ça rend heureux quand on y fait une découverte ! franchement ça vaut une psychanalyse mais bon ce serait pas mal des compte-rendus psychanalytiques de mathématicien.ne.s.
scolairement, les mathématiques apparaissent comme une matière obligatoire. mais la gym aussi ! et c’est donc à ce moment que les environnements socio-économico-culturo-etc. jouent leurs puissances à tout va parce que la gamine et le gamin sont faibles. elle et lui subissent, ne peuvent pas résister. et l’enseignement des maths doit faire avec. et il ne se présente pas forcément comme un allié. cette dimension fondamentale est totalement absente. avec le « français », par contre, on a encore la fiction qui peut jouer un rôle de refuge, pourquoi ne dit-on pas : la mathématique ça devrait faire rêver ? mais si les enseignant.e.s ne sont pas elles et eux -mêmes des poètes, comment transmettre le théorème de Pythagore ?
josef bayéma, plasticien, guadeloupe.