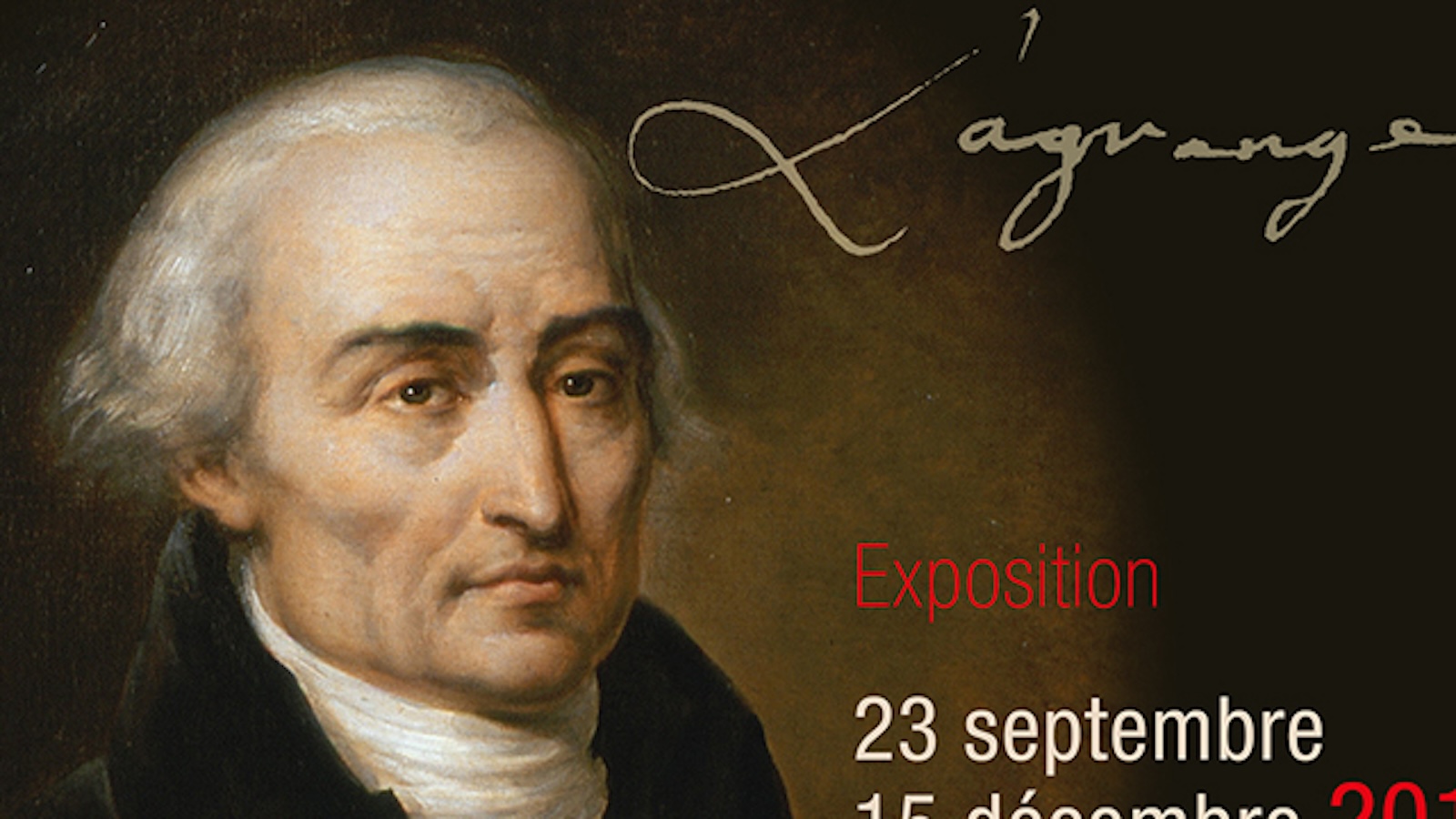
Une exposition est consacrée à Joseph-Louis Lagrange cet automne. À voir à l’École polytechnique- Palaiseau, du 23 septembre au 15 décembre 2013.
L’Institut Henri Poincaré soutient cette exposition en suscitant des convergences avec d’autres événements organisés à l’occasion du bicentenaire du décès du savant. Plus encore, une version inédite du catalogue de l’exposition Lagrange est proposée aux lecteurs d’Image des mathématiques sous la forme de six épisodes dont cet article zéro annonce la parution prochaine.
Chouette, une exposition Lagrange en région parisienne cet automne !
Et une autre à Turin !
Turin, Paris, mais aussi Berlin… Ces lieux habités par Joseph-Louis Lagrange ne sont pas sans susciter d’échos avec les espoirs que nous plaçons aujourd’hui dans la construction européenne. « Lagrange mathématicien européen » est d’ailleurs le titre donné à plusieurs évènements organisés cet automne. Mais la créativité mathématique du savant n’est jamais restée confinée dans un lieu géographique. Au contraire, ses conjectures, démonstrations ou réfutations ont couru les postes européennes pour rejoindre D’Alembert, Euler, Bernouilli, Condorcet… Ces réseaux épistolaires résonnent avec nos toiles d’informations et nos idéaux de circulations des savoirs. Les enjeux de transmissions des sciences ne sont notamment pas moins cruciaux aujourd’hui qu’au temps où Lagrange inaugurait les enseignements de mathématiques à l’Ecole polytechnique et à l’École normale.

Exposition Lagrange à Turin, 19/9-23/11/2013
Pour toutes ces raisons, et d’autres encore, la commémoration du bicentenaire du décès de Lagrange n’est pas seulement l’occasion de saluer un grand savant, dont les travaux marquent la physique et les mathématiques d’aujourd’hui. Cette commémoration nous donne également l’occasion de mettre en perspective les rapports que nous entretenons avec nos propres savoirs, dans nos sociétés contemporaines. Appelé de l’académie de Turin à celle de Berlin par le roi de Prusse, puis à Paris par le roi de France, l’itinéraire de Lagrange interroge les relations entre sciences et sociétés. D’autant que ce dernier est aussi un grand témoin de la chute de l’Ancien Régime. Lagrange s’engage dans la Révolution française, travaille au système métrique et prône l’instauration d’un temps décimal : journée de dix heures, heure de 100 minutes, minute de 100 secondes… Le savant se fait professeur avec les nouvelles institutions d’enseignement créées durant la Révolution. Comte d’empire sous Napoléon, Lagrange est inhumé au Panthéon comme l’un des Grands hommes de la nation française.
De nos jours, de nombreux mathématicien(ne)s et physicien(ne)s manipulent quotidiennement des « Lagrangiens », appliquent le « théorème de Lagrange » ou déterminent des « points de Lagrange ». D’une certaine manière, ces chercheur(e)s, professeur(e)s ou ingénieur(e)s marchent dans les traces du savant décédé il y a deux siècles, traces qui ont été patiemment collectées et éditées au sein des 14 tomes des Œuvres complètes de Lagrange dont la publication s’est étalée sur un quart de siècle, de 1867 à 1892.
Mais, plus concrètement que ces héritages intellectuels, quelles traces Lagrange nous a-t-il laissées de la vie qu’il a vécue ? De nombreuses sources ont été soigneusement conservées durant deux siècles au sein de fonds d’archives comme celui de l’École polytechnique.

Des correspondances manuscrites, encore accompagnées de leurs cachets de cire, documentent les échanges entre Lagrange et sa famille, ainsi qu’avec des savants comme d’Alembert, des autorités politiques comme Talleyrand, ou encore des élèves comme Poisson. On trouve aussi dans ces archives des œuvres d’art : gravures, huile sur toile, médailles… Ou encore de grands parchemins huilés, adressés à Lagrange par les grandes académies européennes pour lui décerner diplômes et honneurs.
Au printemps dernier, des élèves de l’École polytechnique se sont rassemblés autour de ces archives dans le cadre de l’enseignement d’histoire des sciences qui leur est proposé, avec l’aide de leur professeur, ainsi que de l’archiviste, la documentaliste et la restauratrice du Centre de ressources historiques de leur école. Leur travail a donné lieu à la réalisation de l’exposition mise en place dans le grand hall de l’École polytechnique jusqu’au 15 décembre 2013.
L’institut Henri Poincaré a proposé de soutenir cette initiative en favorisant les convergences avec d’autres évènements, comme la réalisation d’un film documentaire ou la journée de commémoration organisée le 6 décembre 2013 dans le cadre du trimestre de cours thématiques du Centre Émile Borel. Les cours de cet automne y sont consacrés à des questions de dynamiques gravitationnelles, fortement marquées par l’héritage des travaux de Lagrange en mécanique céleste.
Dans ce cadre, Images des mathématiques aide l’exposition Lagrange à franchir les murs de l’École polytechnique en proposant à ses lecteurs une version inédite du catalogue de cette exposition, sous la forme de six articles qui seront publiés régulièrement dans le courant de l’automne 2013.
Episode 1 : Les lieux de Lagrange

Episode 2 : faire des mathématiques par lettres



Episode 5 : du savant au professeur

Episode 6 : Lagrange, comte d’Empire

Post-scriptum
La rédaction d’Images des maths, ainsi que l’auteur, remercient pour leur relecture attentive et leurs commentaires : Nicolas Juillet, Jacques Lafontaine et Bruno Langlois.



Il est possible d’utiliser des commandes LaTeX pour rédiger des commentaires — mais nous ne recommandons pas d’en abuser ! Les formules mathématiques doivent être composées avec les balises .
Par exemple, on pourra écrire que sont les deux solutions complexes de l’équation .
Si vous souhaitez ajouter une figure ou déposer un fichier ou pour toute autre question, merci de vous adresser au secrétariat.